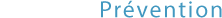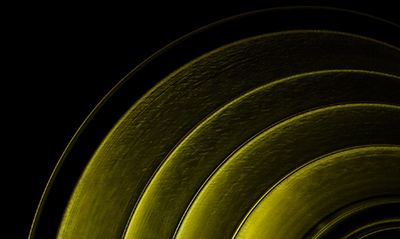Les travaux de toiture réalisés par les charpentiers, les couvreurs, les zingueurs figurent parmi les plus dangereux du BTP, notamment du fait du risque évident de chute de hauteur. Mais les travaux de toiture exposent aussi ces métiers à de nombreux autres risques ...
Les travaux de toiture réalisés par les charpentiers, les couvreurs, les zingueurs figurent parmi les plus dangereux du BTP, notamment du fait du risque évident de chute de hauteur.
Mais les travaux de toiture exposent aussi ces métiers à de nombreux autres risques : l’activité s’exerce toujours à l’extérieur, donc au froid ou à la canicule, exposée aux rayons ultra-violets et au vent..., exige de soulever fréquemment de lourdes charges avec des postures de travail contraignantes, utilise des outils (scies, meuleuses...) susceptibles d’occasionner des blessures, expose à des produits chimiques toxiques (poussières, fumées de soudure, solvants de traitement des bois, colles, plomb, fibres minérales dont l’amiante, bitume...).
La prévention des risques professionnels des charpentiers, couvreurs et zingueurs passe d’abord par une réflexion en amont sur l’organisation du chantier et sur son installation, la mise en œuvre de moyens de protection individuels et collectifs pour le travail en hauteur en respectant les normes de sécurité des échafaudages, des garde-corps et des points d’ancrage des harnais, la bonne utilisation des équipements de levage, des aides à la manutention et des outillages etc. ... A ces mesures de prévention, s’ajoutent le port impératif d’équipements de protection individuelle adaptés et une formation continue à la sécurité du travail et aux bonnes pratiques et gestes professionnels.
Ce dossier ne traite pas des risques spécifiques aux travaux d’imperméabilisation des terrasses réalisés par les étanchéistes.
Les principaux risques des travaux de toiture
Les différents travaux de charpenterie, couverture et zinguerie sont destinés à réaliser ou à restaurer les toitures de tout type de bâtiment, résidentiel, tertiaire ou industriel :
- pose et entretien des éléments en bois ou en métal de l'ossature des toitures.
- évacuation des eaux de pluie (pose des gouttières, chéneaux, tuyaux de descentes...).
- mise en place des matériaux de la toiture (ardoises, tuiles, plaques en fibrociment, tôles ondulées ...) et scellement à l'aide de différents enduits (ciments, plâtres...) ou soudure.
- pose des isolations thermiques intérieures dans les combles et extérieure sur les façades (bardage).
- réalisation de l’étanchéité autour des cheminées, lucarnes...
Le couvreur-zingueur intervient après le charpentier. Si certains travailleurs sont spécialisés dans une seule activité (charpentier ou couvreur ou zingueur), d’autres au contraire sont polyvalents, selon la taille du chantier qui peut aller de simples toitures pour des maisons individuelles à de grandes toitures pour des locaux à usage collectif (salles de sport, piscines, tribunes...) ou industriels (hangars de stockage, entrepôts, hypermarchés, usines...). Beaucoup de risques sont communs à toutes ces activités, avec des particularités en fonction des matériaux utilisés.
-
Les risques de chute de hauteur
Les chutes de hauteur sont la source fréquente d'accidents graves, mortels dans certains cas. Le risque de chute de hauteur est évidemment inhérent aux métiers de charpentier-couvreur-zingueur puisque le travail s’effectue en grande partie en hauteur, avec des déplacements sur échelles, échafaudages et charpentes en bois ou métalliques. On distingue :
- la chute vers l’extérieur du bâtiment depuis les toitures ou les plates-formes de travail, les échelles, les planchers sur échafaudages ou sur consoles, ou lors de la rupture des ancrages ou des fixations,
- la chute à l’intérieur du bâtiment, par exemple lors de travaux sur la panne faîtière (fixation des chevrons) ou de circulation sur un toit fragile, ou en passant à travers le toit sur des éléments transparents de toitures comme les lanterneaux de lumière ou de désenfumage, ou en chutant dans les ouvertures dans les surfaces de toits en cours de couverture.
Les causes des chutes de hauteur sont nombreuses :
- les accès en pente glissants,
- les obstacles de toute nature sur les plates-formes, passerelles ou planchers d’échafaudages surchargés et encombrés,
- les échelles mal entretenues, mal placées et/ou mal fixées, entrainant leur glissement ou renversement,
- le montage et démontage non conformes aux règles de sécurité des moyens de protection collective (filets de sécurité, points d’ancrage, lignes de vie...),
- les échafaudages vétustes, inadaptés, mal stabilisés,
- l’absence d’accès sécurisés, de garde-corps, de protections périphériques des plans de travail,
- l’absence de protection des balcons, cages d’escalier et d’ascenseur...
- l’effondrement de la structure porteuse en construction ou en utilisation,
- l’action de sauter à terre pour descendre...
Les lésions causées par ces chutes sont habituellement graves (traumatismes crâniens, fractures du bassin ou de membres, ...), exigeant de longues périodes de traitement et de convalescence, avec des séquelles pouvant être importantes, et dans de nombreux cas, il s’agit d’accidents du travail mortels. -
Les risques de chutes de plain-pied ou de celles d’objets
Les déplacements fréquents sur le chantier sur un sol inégal, encombré, mal éclairé, comportant des vides (regards, ...) et/ou glissant induisent de nombreux risques physiques : plaies et hématomes, fractures et entorses dues aux chutes de plain-pied, traumatismes crâniens et écrasements des membres en raison de la chute d’objets ou de matériaux des échafaudages ou des étages supérieurs. -
Risques liés aux postures et manutentions
Les postures de travail contraignantes (torsions, position accroupie ou à genoux prolongée, travail en équilibre instable ...), des charges lourdes manutentionnées toute la journée (déplacement des pièces en bois ou en métal, des tuiles, ardoises...) des gestes répétitifs (pointage au marteau, vissage, boulonnage ou rivetage par exemple), provoquent des hyper sollicitations et entrainent des troubles musculo-squelettiques très fréquents à l’origine de nombreux accidents du travail. De plus, les vibrations transmises aux bras et aux mains par l’outillage portatif viennent aggraver l’exposition à ces risques.
Des aides à la manutention indisponibles ou insuffisantes, des manutentions manuelles non évitées par des mesures d’organisation appropriées, contribuent largement à la pénibilité physique et à la survenue de lésions articulaires et de lombalgies d'effort. Les lésions de la colonne vertébrale, les douleurs des poignets, des épaules, etc., ainsi que les traumatismes aux genoux et aux chevilles sont particulièrement fréquents chez les charpentiers et couvreurs. -
Risques liés au travail en extérieur
Le travail en extérieur conduit les charpentiers et couvreurs à être exposés aux ultraviolets (UV), aux intempéries, au froid ou à la chaleur, et à l’humidité. Ces conditions climatiques variables (gel, chaleur, pluie, vent) accentuent les risques liés aux postures de travail contraignantes et ne permettent pas de travailler en toute sécurité.
L’exposition fréquente aux UV, surtout torse nu, peut être responsable de cancers de la peau, d’ophtalmies (brûlure de la cornée) particulièrement en altitude, et, en tout cas, d’érythème solaire (coup de soleil).
Les problèmes de santé dus à la chaleur et à l'action prolongée du rayonnement solaire sur la tête (effets de l’insolation, de la déshydratation...) génèrent des risques de malaise général, de crampes musculaires, de pertes de connaissance, qui peuvent être vitaux dans les cas extrêmes (coup de chaleur). Indirectement, le travail par fortes chaleurs augmente aussi les risques d'accidents du travail par la fatigue, la sudation, la diminution de la vigilance.
Pour des travaux en extérieur, le risque lié au froid est accru par une exposition au vent (refroidissement éolien) et à l’humidité. Le refroidissement des parties du corps peut provoquer des engelures, lésions cutanées qui deviennent rouge violacées, douloureuses, avec des crevasses et/ou des phlyctènes. Les mains et les pieds (surtout doigts ou orteils) ont tendance à se refroidir plus rapidement que le torse :
l’exposition au froid est susceptible de déclencher le syndrome de Raynaud (doigts blancs et douloureux par vasoconstriction). Comme pour la chaleur, le froid entraine des risques indirects, favorisés par la diminution de la dextérité due au refroidissement des extrémités, à la diminution des performances musculaires et à l’incapacité à effectuer des mouvements fins. La vigilance mentale est également réduite en raison de l'inconfort causé par le froid. -
Risques chimiques
- Les produits de traitements antifongiques et antiparasitaires des bois de charpente, en application curative par pulvérisation ou badigeonnage, contiennent des agents très toxiques (pentachlorophénol PCP, pyrèthres et pyréthrinoides, sels ou oxydes minéraux ou organo-métalliques d’étain, de cuivre, de chrome, d’arsenic...), dilués dans des solvants organiques eux-mêmes nocifs (xylène, le white spirit...) ou en phase aqueuse. On distingue les effets aigus (dus à des concentrations élevées notamment dans un espace confiné) et chroniques (dus à de faibles concentrations, mais à des expositions répétées). Ces produits, dont les composés organiques des solvants, affectent des organes cibles divers : irritations des yeux et de la gorge, des organes respiratoires (asthme...), troubles cardiaques, digestifs (nausées...), du système nerveux, maux de tête, vertiges, somnolence ...
- Les fibres des laines d’isolation minérales de verre, de roche sont nocives par inhalation : elles sont responsables d'atteintes des voies respiratoires et lorsqu’une quantité importante de ces particules de poussière irritantes se logent dans le nez, elles peuvent causer une rhinite allergique ou une inflammation de la muqueuse nasale. Certaines particules très fines réussissent à traverser la cavité nasale et à s'attaquer à la trachée et aux poumons, ou elles engendrent une inflammation des muqueuses de la trachée ou des bronches. L’inhalation constante dans les poumons de fibres peut causer une pneumopathie chronique et de l’asthme.
Les laines d’isolation provoquent aussi des irritations cutanées à leur contact (phrase de risque R38) qui se traduisent par des lésions plus ou moins importantes telles des rougeurs, des démangeaisons (prurit). Une dermite d’irritation, due à des contacts excessifs avec ces produits irritants, peut créer une prédisposition à l’urticaire et à l’eczéma.
Quant au risque cancérogène, les laines d’isolation sont classées en catégorie 3 (phrase de risque R40, c'est-à-dire substances préoccupantes pour l’homme en raison d’effets cancérogènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une évaluation satisfaisante).
- Les colles dans un mélange de solvants qui doivent s’évaporer pour permettre la prise (toluène, xylène, ...), génère des Composés Organiques Volatils (COV) provoquant des troubles neurologiques (céphalées, vertiges, agitation ou somnolence, ...), des irritations pour les yeux et la peau et, aux fortes concentrations, des convulsions, des affections gastro-intestinales accompagnées de vomissements. Les résines des colles peuvent être à l’origine de dermatite de contact allergique (eczéma), avec sensibilisation progressive à ces produits de façon spécifique du fait de la multiplicité des contacts cutanés non protégés.
- Les opérations de sciage du bois génèrent une quantité importante de fines poussières de bois : ces particules de poussière irritantes se logent dans le nez, et certaines particules très fines réussissent à traverser la cavité nasale et à s'attaquer à la trachée et aux poumons, ou elles engendrent une inflammation des muqueuses des bronches : l’inhalation de poussières de bois provoquent des rhinites et peuvent être à l’origine de réactions asthmatiques.
Par ailleurs, l’exposition aux poussières de bois génère un risque de cancer naso-sinusien, qui, même si c’est rare et d’apparition tardive, a été longtemps sous-estimé.
- L’exposition aux poussières de silice, d'amiante et d'ardoise génère des risques de lésions pleurales, fibroses pulmonaires, cancer broncho-pulmonaire. Le risque d’exposition à l’amiante existe dans les travaux de rénovation ou l’amiante se trouvent dans les plaques ondulées de fibrociment ou les produits de bardage dans les constructions datant d’avant 1978. Ce sont les opérations libératrices de fibres qui sont les plus dangereuses : découpe pour l’ouverture dans une toiture en amiante-ciment pour le passage d'une gaine d’extraction d’air, d’une cheminée..., perçage, manipulation de plaques détériorées, démoussage avec un nettoyeur haute pression... Mais la simple dépose des plaques du support (crochets, tirefonds, agrafes...) peut occasionner une dégradation mécanique brutale ou la casse due à la vétusté.
- Les fumées de soudure, lors du soudage de tôle galvanisée ou de rectification des pièces métalliques à l’oxycoupage ou soudage à l’arc, sont irritantes et toxiques et sont responsables de diverses pathologies importantes.
En cas d’inhalation massive d’irritants, on peut observer des effets respiratoires aigus (toux, dyspnée associées à une hyperactivité bronchique qui pourra alors persister plusieurs mois).
Les effets respiratoires chroniques n’apparaissent qu’après une exposition régulière et prolongée (sidérose, sidérosclérose, asthme, broncho-pneumopathies chroniques ...)
Les fumées de soudage sont répertoriées cancérogènes
- L’exposition au plomb des travailleurs dans les bâtiments anciens (monuments historiques en particulier), entraine des risques lors de découpage de tôles ou autres pièces métalliques recouvertes de minium antirouille (tétraoxyde de plomb), de grattages de charpentes recouvertes de peintures au plomb anciennes, de dépose des vieilles couvertures au plomb.
Les effets néfastes du plomb résident dans sa toxicité sanguine, neurologique et rénale (anémies, neurasthénies, insuffisances d’élimination urinaire...)
- Les décapants pour toiture (acide chlorhydrique) sont particulièrement caustiques pour la peau et irritants respiratoires.
- Les plaques bitumineuses d’étanchéité ou les bandes bitumineuses de renfort..., génèrent surtout la possibilité d’expositions cutanées, notamment aux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), par contact direct avec le bitume et les vêtements ou outils souillés, pouvant provoquer des irritations de la peau.
- La toxicité cutanée du ciment est susceptible d’induire des problèmes dermatologiques pour les couvreurs lors du scellement des tuiles faîtières et des tuiles de rives : dermites d’irritation, dermites allergiques. -
Risques physiques liés aux outils
Pour scier et clouer les supports en bois, pour fixer le revêtement de toiture, pour façonner et poser les pièces de zinguerie, souder, boulonner, visser ou riveter des pièces métalliques, les charpentiers, couvreurs-zingueurs utilisent des outils à main ou électriques portatifs tranchant ou contondant occasionnant des blessures notamment aux mains par contact avec l'outil, rupture de lame... Ces outils, tronçonneuses, scies, meuleuses, perceuses, visseuses, pistolets de scellement, riveteuses, marteaux ... provoquent aussi des expositions aux vibrations provoquant des atteintes pathologiques ostéoarticulaires et angioneurotiques qui concernent principalement les membres supérieurs, les mains et la colonne vertébrale, par transmission des vibrations au bras ou au corps entier. L’emploi d'appareil avec jet sous haute pression pour le nettoyage et le décapage, expose au risque du coup de fouet d’un flexible, de projections de débris pulvérisés par le jet, en particulier dans les yeux. -
Autres risques
Les chantiers ou travaillent les charpentiers, couvreurs-zingueurs présentent d’autres risques moins spécifiques : risques électriques (causés par des installations temporaires précaires, avec des câbles, des prises ou des outils portatifs défectueux, ou électrisation lors de travail à proximité de lignes électriques aériennes), risques sonores (bruit environnant du chantier, des outils utilisés lors des assemblages, de la fixation des éléments métalliques, de l’usage au marteau...).
Les mesures de prévention des risques des travaux de toiture
Les moyens de prévention à mettre en œuvre pour pallier les risques professionnels des charpentiers et couvreurs-zingueurs résident d’abord dans la prévention collective (organisation, installations, produits...) qui diminue fortement les expositions et la fréquence ces accidents, puis dans la prévention individuelle (équipements de protection) qui en diminue nettement la gravité, enfin dans la formation à la sécurité. La prévention collective concerne surtout le bon usage des installations de travail en hauteur, l’emploi de produits de substitution de moindre impact potentiel sur l'homme, des aides à la manutention et des outils adaptés, le respect des règles générales d’hygiène... Les différents risques professionnels doivent faire l’objet d’une évaluation pour permettre la rédaction du Document Unique de Sécurité (Décret du 5 novembre 2001) en appréciant à la fois l’environnement matériel et technique (outils, machines, produits utilisés) et l’efficacité des moyens de protection existants et de leur utilisation selon les postes de travail.
De manière aussi à ce que les salariés puissent être informés à propos des produits dangereux utilisés, les Fiches de Données de Sécurité (F.D.S.) doivent être mises à disposition et la connaissance de leurs risques expliquée au travers de la compréhension de leur étiquetage.
-
L’organisation du chantier
La première des mesures de prévention passe par une réflexion en amont sur l’organisation et l’installation du chantier : implantation, organisation des flux, circulation des opérateurs, des engins et des approvisionnements.
La plupart des chutes de plain-pied et d’objets trouvent leur origine sur un chantier mal organisé et mal rangé. A ce titre, le balisage, l’éclairage et la sécurisation des voies de circulation et des zones de stockage sont essentielles ainsi que le rangement en permanence du chantier (palettes, câbles, tuyauteries, matériaux et outils divers...) et la signalisation par des dispositifs visibles des obstacles de toute nature (antenne TV, lignes électriques aériennes...). Les ouvertures dans les surfaces de toits et les lucarnes doivent être protégées pour empêcher toute chute (recouvrement, garde-corps ou filet de recueil).
Une bonne organisation du chantier permet aussi d’éviter des ports de charge et des mouvements répétés inutiles et d’avoir les matériaux à disposition et à la bonne hauteur, donc de réduire les risques physiques liés à la manutention. Le travail sur les chantiers de toiture nécessite au préalable de prévoir le plan d'installation de chantier, d’assurer les vérifications des appareils, des échafaudages, des installations électriques.
En ce qui concerne l'exécution des travaux en hauteur, celle-ci doit s'effectuer en priorité à partir d'un plan de travail conçu, construit et équipé de manière à garantir la santé et la sécurité des travailleurs, et dans des conditions de travail ergonomiques (article R. 233-13-20 du Code du travail).
La dépose de plaques amiante-ciment de l’ensemble d’une toiture nécessite un plan de retrait en rentrant dans la catégorie des travaux de « retrait d’amiante non friable à risques particuliers » (arrêté du 22/02/2007) après avoir obtenu un certificat de qualification. Par ailleurs, sur les chantiers du BTP, des abris ou cantonnements doivent accueillir des vestiaires, des sanitaires et toilettes, voire des douches pour apporter les conditions d'hygiène nécessaires aux travailleurs. Loin d'être optionnelle, la présence de ces abris relève du domaine réglementaire (Code du travail, articles R4228). -
La coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS)
Pour limiter les risques induits par la co-activité, le législateur a prévu de rendre obligatoire l'intervention d'un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé SPS dans les chantiers importants ou travaillent plusieurs entreprises. Un coordinateur SPS rédigeant un Plan Général de Coordination (PGC) est ainsi requis pour tous les chantiers importants sur lesquels interviennent, simultanément ou successivement, plusieurs entreprises, même en sous-traitance l’une de l’autre. Il assure la coordination au stade de la conception (identification des risques, description des procédures et moyens qui permettront de les éviter) et en cours de chantier. L’objectif est de prendre les précautions nécessaires avec les autres corps d’état et d’assurer les relations sur le chantier avec l’entreprise générale, le maître d’œuvre, les organismes de contrôle. -
Les installations de travail en hauteur
Chaque fois que cela est possible, il est nécessaire de prévoir un maximum d’opérations au sol (sciage, découpe des rouleaux de zinc ou de papier d’étanchéité par exemple) pour diminuer à la fois la charge à monter et le travail à réaliser en hauteur, afin de minimiser les occasions de risques de chute.
La sécurité collective est assurée par le montage d’un échafaudage périphérique protégeant le charpentier et le couvreur par rapport à d’éventuelles chutes vers l’extérieur.
La prévention des chutes de hauteur est assurée par des accès sécurisés (passerelle, dispositif antichute) grâce à des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et résistants, qui dispensent les travailleurs du port du harnais et évitent la pose des ancrages parfois problématique pour certaines structures ou ouvrages temporaires ou vétustes.
- La circulation en hauteur doit s’effectuer en sécurité sans créer de risque de chute lors du passage entre un moyen d’accès et des plateformes, planchers ou passerelles. On doit utiliser des filets antichute au plus près de la structure sous la couverture, des protections en bas de pente et en rives latérales, des cheminements ou planchers de circulation sur les couvertures en matériaux fragiles, des échelles de toit souples à marches antidérapantes. - Les échafaudages doivent être conformes à la réglementation et régulièrement contrôlés.
L’échafaudage de pied doit être le choix privilégié, car il peut s’adapter à tout type de bâtiment. Les échafaudages doivent être montés et utilisés conformément aux dispositions prévues par le fabricant et maintenus dans cette configuration pour bénéficier de toutes ses qualités de résistance et de fiabilité. Ceci concerne aussi les dispositions en matière de stabilisation de l'échafaudage. L'accès aux planchers de travail doit être réalisé par l'intérieur, grâce à des planchers équipés de trappes et d'échelles d'accès, de préférence inclinées. Un garde-corps supplémentaire doit être prévu au niveau de la travée d'accès pour éviter le risque de chute de hauteur depuis l'échelle. Il convient de vérifier que les planchers d’échafaudage, les passerelles, ne sont pas surchargés et encombrés. Les surfaces d’appuis au sol sont à déterminer en fonction des charges de l’échafaudage, poids propre et charges d’exploitation. Ces charges permettent de déterminer la pression au sol en fonction de la surface d’appui. La gamme de sécurité et protection pour échafaudages comporte notamment :
• le garde-corps de montage et de sécurité
• les liens pour bâche pour la sécurisation des bâches d'échafaudages sur les échafaudages,
• les filets à débris et les systèmes de filets de sécurité pour le captage des chutes de débris,
• les plaques pour pieds d'échafaudage pour la stabilité des échafaudages,
• les capes pour extrémités de tubes et le ruban adhésif de sécurité.
Les échafaudages sur taquets d’échelle sont interdits, les plates-formes sur tréteaux vivement déconseillés.
- Une bonne utilisation des échelles.
Les plates-formes de travail ou les nacelles sont beaucoup plus stables que les échelles et doivent donc être mises en place préférentiellement. Les échelles portables sont des outils exclusivement utilisés pour accéder à un niveau supérieur à défaut d’escalier ou d’échelle fixe ; c’est avant tout un moyen d’accès. Ce n’est qu’occasionnellement que les échelles portables peuvent être utilisées comme poste de travail, s’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas de caractère répétitif ou risqué. Dans tous les cas, des mesures particulières de sécurité doivent être prises : l’échelle doit reposer sur des supports stables et résistants, leurs échelons ou marches doivent être horizontaux. Pour ne pas qu’elle glisse ou bascule, l’échelle est soit fixée dans la partie supérieure ou inférieure de ses montants, soit maintenue en place au moyen de tout dispositif antidérapant. Il ne faut jamais travailler à deux sur une échelle même si elle est double. L’échelle doit dépasser d’au moins un mètre le niveau d’accès. -
Les aides à la manutention
La manutention manuelle risque de rester importante malgré le montage au sol et c’est pourquoi l'utilisation d'engins de levage et de manutention assistée doit être le plus systématique possible.
Les travaux de toiture comportent en effet de nombreuses manutentions de charges lourdes qui entraînent des risques évidents de troubles musculo-squelettiques au niveau du dos et des articulations, qui peuvent être réduits par l’utilisation systématique de manutention assistée : treuils de levage, monte-matériaux, potences, palans à moteur, chariot élévateur à flèche télescopique et nacelle, chariots de toits pour faciliter l’approvisionnement en tuiles, transpalettes, brouettes... Les accessoires de levage doivent être appropriés au conditionnement des matériaux et matériel (fourche à filet, panier de manutention...). L’utilisation des accessoires de levage comportent aussi par eux-mêmes des risques : il convient de respecter les charges maximales qu’ils peuvent supporter, et de ne pas rester dans le rayon d’action des engins de levage pour éviter le risque d'accident en cas de mauvaise manœuvre avec heurt du personnel du chantier avec la charge. Le bon arrimage des charges et leur guidage en cours de levage, des élingues et accessoires régulièrement vérifiés et entretenus sont des actions indispensables à la sécurité des charpentiers et couvreurs, de même que la prise en compte de la résistance de la surface d’appui de l’appareil de levage pour éviter le renversement.
Par ailleurs, il convient d’éviter le port manuel répété de charges trop lourdes en choisissant des outils et des conditionnements de poids réduits (rouleaux d’étanchéité de moindre surface, petits paquets de tuiles ou d’ardoises...). -
Le choix des produits
La première étape consiste à repérer en particulier les agents chimiques cancérogènes ou dangereux dans le cadre de l'évaluation des risques du Document Unique de Sécurité (DUS).
Les Fiches de Données de Sécurité (FDS), obligatoires pour tout produit chimique dangereux, comportent les renseignements relatifs à la toxicité des produits, donc notamment leur caractère cancérogène éventuel. La suppression ou la substitution des produits cancérogènes ou dangereux est la mesure de prévention prioritaire qui s'impose : par exemple, l’utilisation de colle ou de produits de traitement des bois en phase aqueuse peut être une solution ainsi que celle des produits les moins volatils (pression vapeur plus faible).
Mais la recherche de substituts peut être difficile dans certains cas et alors, la connaissance des risques induits par les produits permet de mettre en œuvre des mesures de prévention individuelle adaptées. -
La protection individuelle
Elle passe d’abord par le respect des règles d’hygiène personnelle : ne pas fumer, se laver les mains fréquemment pour ne pas avoir les mains sales afin de ne pas ingérer par inadvertance un produit toxique, ne pas manger sur le lieu de travail, tenues de ville et tenues de travail distinctes et rangées séparément, boire de l’eau régulièrement et abondamment lors de fortes chaleurs, utiliser des crèmes protectrices des mains et des écrans solaires, ne pas travailler le torse nu et les bras et jambes découvertes.
Puis, pour travailler en toute sécurité, le charpentier et le couvreur doivent se protéger la tête, le corps, les mains, le visage, les voies respiratoires et les yeux et donc recourir impérativement à des équipements de protection individuelle communs, notamment adaptés aux conditions de travail à l’extérieur, ou spécifiques à certaines taches effectuées.
- Casque de chantier pour se protéger des chutes d’objets, qui doivent être remplacés régulièrement, et en tout cas, s’il y a eu un choc,
- Chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes, avec embout protecteur et semelle anti-perforation,
- Lunettes de protection (notamment en cas d’utilisation des meuleuses, tronçonneuses, scies,...) et anti UV,
- Genouillères ou un pantalon à genouillère type « hygrovet » pour les travaux au sol,
- Vêtements adaptés aux travaux du bâtiment et aux conditions climatiques,
- Gants adaptés à chaque usage : gants de manutention épais et renforcés pour la manutention, anti-coupures pour la découpe, gants de néoprène ou nitrile avec un revêtement intérieur en coton et des manchettes remontant haut sur les avants bras pour éviter tout contact direct avec le ciment, les solvants et les produits bitumineux.
• Cas de l’exposition à l’amiante
Pour réduire l’exposition à l’amiante, il convient d’abord d’adopter de bonnes méthodes de travail : ne pas utiliser d’outils de découpe ou de perçage à vitesse de rotation élevée, humidifier avec de l’eau ou un produit spécifique la zone à casser ou à découper pour fixer au maximum les fibres, nettoyer les structures et le sol par aspersion ou aspiration avec un appareil équipé d’un filtre absolu. Ensuite, il convient de disposer d’une combinaison jetable et d’un demi-masque de protection respiratoire doté d’un filtre P3 jeté en fin de poste. Enfin, il faut déposer les déchets amiantés dans des sacs spécifiques, étiquetés, recouverts d’un film en matière plastique au fur et à mesure de leur production, puis acheminés vers une installation de stockage autorisée avec un bordereau de suivi.
• Cas de l’exposition aux poussières
Lors de la manipulation des laines isolantes, de sciage des éléments de charpente, d’exposition aux poussières de bois, de silice, d’oxyde de fer et de plomb, le port de masques anti-poussières fines à ventilation libre de type FFP2, en papier ou cartonnés, légers, jetables, filtrent les particules lors d’émission modérée de ces poussières en milieu non confiné, ce qui est le cas général pour les travaux de toiture.
• Cas de la protection du soudage
Le port de lunettes de protection ou de casque écran de soudage adéquat est fondamental, ainsi que des gants en cuir avec manchettes. -
La formation à la sécurité
L’information et la formation des charpentiers et couvreurs sur les risques et les techniques d’utilisation des équipements et des produits est absolument nécessaire pour diminuer de façon pérenne le niveau de criticité des travaux de toiture :
- Formation à la sécurité des équipements (par exemple, pour le montage et démontage des échafaudages, l’utilisation des échelles, les techniques de levage et d’élingage),
- Formation PRAP (Prévention des Risques liés à l'Activité Physique) : l’OPPBTP a développé une démarche appelée ADAPT-BTP (Aide à la Démarche d’Amélioration des situations et des Postes de Travail) qui vise à prévenir les risques liés à l’activité physique. Il s’agit d’apprendre les bonnes postures de travail, les positions articulaires adéquates, en appliquant les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort.
- Formation sur le travail en hauteur,
- Formation à la lecture de l'étiquetage des produits,
- Formation aux risques amiante, fibres, plomb ... -
La surveillance médico-professionnelle
L’exposition au plomb, à l’amiante, aux solvants, impose une surveillance périodique des travailleurs au moins une fois par an, instaurée par le médecin du travail, avec un suivi médical et toxicologique approprié obligatoire (analyses biologiques, radiologiques...). Chaque salarié ainsi exposé à des produits chimiques dangereux ou cancérogènes doit faire l’objet d’une fiche d'exposition établie par l'employeur et bénéficier d’une surveillance médicale renforcée. A sa sortie de l’entreprise, il doit recevoir une attestation d’exposition qui lui permettra de continuer à se faire suivre médicalement.
Novembre 2011
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.
Les avis des internautes
20/02/2023